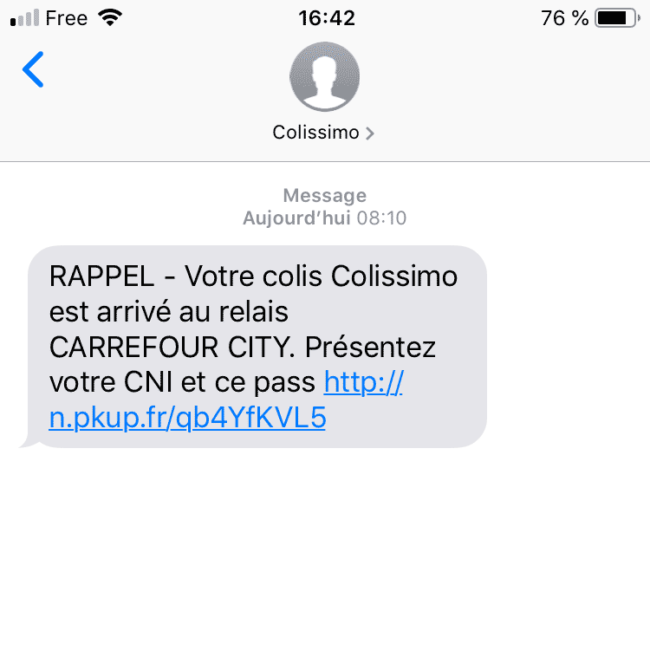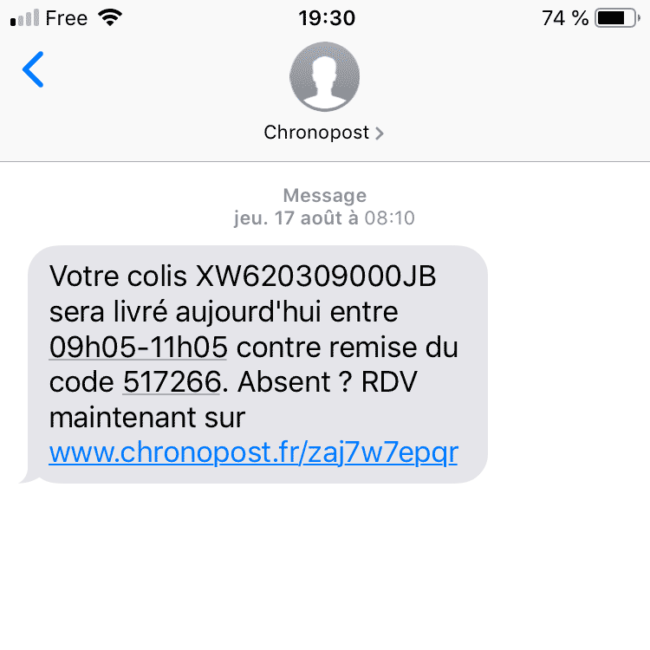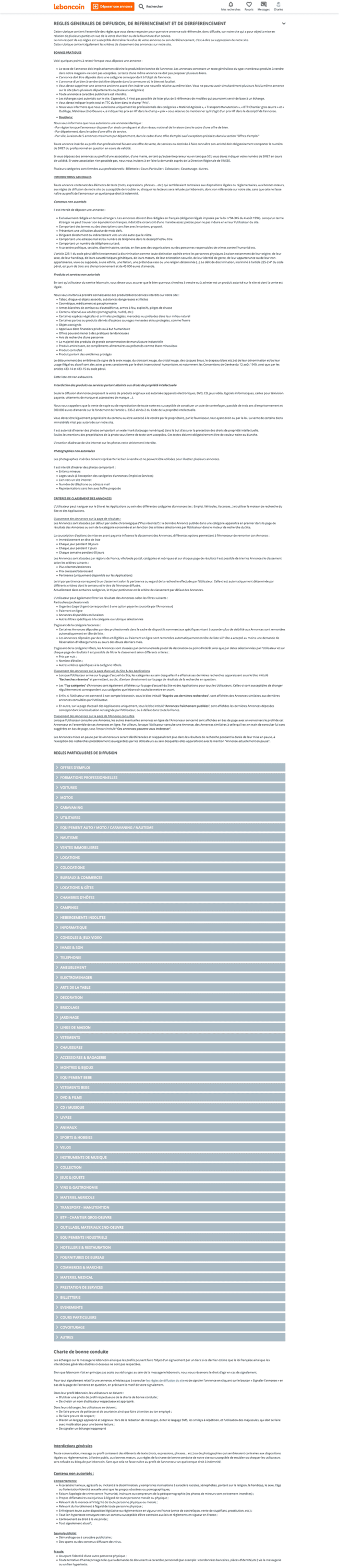Résumé : la certification Opquast c’est super, foncez !
J’ai passé la certification Opquast il y a quelques mois. Le site d’Opquast la définit comme une formation en ligne de 14 heures en autonomie, destinée à tous les professionnels du web quels que soient leur niveau et leur métier, dont le but est d’acquérir un socle de connaissances transversales, d’apprendre un vocabulaire commun et de comprendre les exigences des utilisateurs (entre autres ; voir la définition complète sur le site). Voici mes impressions au sujet de la formation, qui repose sur un e-book* et une plateforme en ligne.
1. Le guide de certification
L’e-book est fourni au format PDF. Sur ma vieille liseuse (Kobo Aura HD), ce format de fichier ne permet malheureusement pas de redimensionner le texte, ce qui rend le guide impossible à lire. C’est dommage, mais peut-être qu’avec du matériel plus récent le problème ne se pose pas.
Le contenu de ce guide, tiré du livre Assurance Qualité Web mentionné plus haut, représente le socle de la formation. Il se compose de trois parties principales :
- l’assurance qualité web
- les règles Opquast
- le glossaire
Chacune de ces parties sera évaluée en détails, à plusieurs reprises, au sein des différents quiz en ligne. Si les règles représentent logiquement le cœur de la formation, la première partie Assurance qualité web, et son modèle VPTCS en particulier, ne doit pas être négligée par les personnes qui visent un score élevé à l’examen.
Le guide m’a beaucoup plu, en particulier les 240 règles, qui conviennent bien à ma façon de penser et de travailler. Quelques détails m’ont toutefois un peu ennuyé :
- je trouve qu’il manque d’exemples. Certaines règles s’appliquent à certains types de sites plutôt qu’à d’autres, et je trouve dommage de ne pas montrer leur utilité plus concrètement.
- les réponses aux questions du questionnaire n’y sont pas toujours énoncées clairement. Je pense par exemple à certaines questions relatives à la validation à telle ou telle étape du processus de création de site : les réponses ne sont pas faciles à trouver.
2. Le site internet
La plateforme en ligne s’appuie sur deux types de supports principaux : de courtes vidéos de l’équipe de formation, ainsi qu’une vingtaine de quiz. C’est sur ce site internet que les personnes en formation vont passer la majeure partie de leur temps.
Les quiz se compliquent au fil du temps : le premier comporte 8 questions (5 minutes), le dernier 125 (1h30). Un quiz peut être fait plusieurs fois, les questions ne seront pas toujours les mêmes et leur ordre variera. Il est inutile d’apprendre les réponses par cœur : l’examen final a son propre jeu de questions.
J’aime beaucoup ce système de quiz, son côté ludique me plaît, en revanche il a ses limites :
- la tournure de certaines questions est volontairement alambiquée (voir plus bas), ce qui laisse penser que l’équipe de conception cherche un peu trop la petite bête ;
- (corollaire) on trouve la réponse à de nombreuses questions par élimination, une pratique un peu éloignée de la réalité ;
- l’usage de certains termes, de certaines expressions est problématique : l’exemple le plus étrange est la fenêtre dimensionnée, une expression que même Google connaît mal (une quarantaine de résultats). J’ai trouvé quelques rares notions un peu floues, par exemple à propos des storyboard, des maquettes semi fonctionnelle, des wireframe etc.
- les réponses aux derniers quiz ne sont pas fournies, bien que leurs questions soient parmi les plus retorses. Même avec le guide sous les yeux, certaines réponses posent de sérieux problèmes !
Le score à l’examen final
Le système de paliers du score peut paraître frustrant : on est Expert (5 étoiles) à 900 points (et au delà)… mais une petite erreur de plus vous relègue au niveau Avancé (4 étoiles). C’est logique bien sûr, mais certaines questions sont tellement alambiquées qu’on peut vite perdre des points pour des raisons un peu sottes, alors que la différence entre un profil « 895 » et un profil « 900 » est en pratique inexistante. Je doute que la situation ne se présente un jour, mais privilégier l’embauche d’un « 900 » sur celle d’un « 895 » sous le seul prétexte qu’il a 5 étoiles et pas 4 ne serait pas forcément une bonne idée.
Autre point notable au sujet du score : le questionnaire est conçu pour qu’il soit presque impossible de ne faire aucune erreur (sur plus de 13.000 participations, une seule personne a fait 1000/1000). J’ai échangé à ce sujet avec Elie Sloïm, l’un des concepteurs de la formation, qui m’a confirmé que « ce n’est pas parce que l’on potasse beaucoup que l’on fera automatiquement 1000/1000 ». J’ai ainsi présenté certaines questions au recordman du monde, qui n’a pas réussi à répondre à toutes avec assurance.
Dernier point important : il n’est pas nécessaire de viser le meilleur score possible. Cette note du blog Opquast l’explique, le score minimum à viser dépend du profil de chaque personne :
• Si vous avez un profil marketing, commercial, publicité ou si vous exercez un métier de management ou de décideur, un niveau de 500 à 600 points est déjà correct.
• Les profils rédacteurs de contenus, contributeurs, peuvent viser un minimum de 600 points.
• Les profils chef de projet, community manager, graphistes, ergonomes, UX peuvent viser les 700 points.
• Les profils techniques, intégrateurs, développeurs, spécialistes SEO doivent viser 800 points.
• Les 900 points sont souvent réservés aux experts de la qualité.
Personnellement je tenais à faire le meilleur score possible : le sujet m’intéresse beaucoup et j’aimerais à l’avenir travailler davantage sur des sujets liés à la qualité web. Ce n’est toutefois pas le cas de tout le monde, et un score bas n’est pas nécessairement un mauvais score. Le choix des mots est important, d’ailleurs : on ne parle pas ici de note mais bien de score.
Pourquoi c’est bien ?
Ce long retour donne beaucoup de place aux points qui m’ont gêné, pourtant comme je l’ai dit plusieurs fois j’ai beaucoup apprécié la formation.
- Elle traite de nombreux domaines qu’il est à mon avis indispensable de connaître voire de maîtriser lorsque l’on conçoit des sites en 2022 : accessibilité, design, performance, intégration, rédaction, éco-conception…
- Sa richesse en fait un point d’entrée sérieux au monde de la conception web. Pas aussi exhaustive que peuvent l’être des référentiels dédiés comme le RGAA par exemple, sa transversalité (elle recoupe plusieurs disciplines) et son accessibilité (au sens : que l’on peut comprendre) font sa force.
- Elle donne à toutes les parties prenantes de la chaine une base commune de qualité, quels que soient leurs scores à l’examen final, ce qui représente un atout indéniable dans le cadre d’un projet web contemporain.
- Elle est à jour et elle est tenue à jour. Le nouveau livre vient de sortir : c’est la troisième édition en dix ans.
- Elle est courte, même si le chiffre de 14 heures me semble sous-évalué, pour obtenir un score élevé tout du moins. (J’y ai passé beaucoup plus de temps que ça.)
- Amélie Boucher a préfacé la dernière édition : n’est-ce pas un gage de qualité ?
Conseils aux futurs apprenant·es
J’ai pu échanger avec différentes personnes de la communauté Opquast tout au long de ma formation. Voici quelques conseils à celles et ceux qui voudraient se lancer.
En phase d’apprentissage :
- lisez et relisez le guide. Se contenter de connaitre les quiz par cœur ne vous garantit pas un score élevé.
- faites des copies d’écran des questions qui vous posent problème (avant et/ou après correction). Vous pourrez y revenir ensuite et réviser ces points en particulier.
- ne vous contentez pas de lire les intitulés des règles : lisez également les objectifs. Leur contenu est évoqué dans les questions de l’examen final.
Au cours de l’examen :
- mettez-vous dans de bonnes conditions (testez votre installation la veille, par exemple). Buvez de l’eau avant, mais pas trop : 1h30, ça peut être long…
- lisez très attentivement les questions. Comme je l’ai déjà dit, le diable se cache parfois dans les détails.
J’espère que ce retour vous aura convaincu de l’intérêt de la certification Opquast. Je suis personnellement très fier de faire désormais partie de cette communauté. À celles et ceux qui voudraient se lancer : bonne chance ! Il en faudra un peu, pour éviter les questions les plus alambiquées…
* Note : je ne possède pas la dernière version du guide. Les remarques au sujet du format ne sont peut-être plus valables. Retour en haut